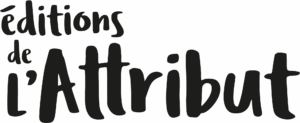Mélissa Plaza, la fille qui voulait jouer au foot
En juillet, l’ex-footballeuse Mélissa Plaza a présenté son seule en scène « 140 BPM » dans le Off du Festival d’Avignon. Un spectacle « poético-subversif » en huit chapitres, nourri de ses souvenirs, où il est question du sport qui fracture, mais aussi qui répare.
Mélissa Plaza, si vous aviez un souvenir de sport parmi tous les autres, ce serait lequel ?
Je me souviens des parties de football interminables jouées l’été chez ma grand-mère à Pornichet. J’avais une dizaine d’années et sur ce petit terrain en dur, je jouais du matin au soir avec mes copains de vacances. Je rentrais juste pour déjeuner le midi et aller chercher mon goûter. Il faisait chaud, je portais un bermuda et un tee-shirt ample qui me laissait libre de mes mouvements, les journées passaient vite et il n’y avait que ça qui comptait.
Et un autre souvenir remontant à l’enfance ?
Je me souviens de la cour de récréation, dans mon école en Haute-Savoie, et de la fierté éprouvée quand, à force d’insistance et de démonstration de mes qualités, j’ai non seulement eu ma place sur le terrain mais suis aussi devenue capitaine, habilitée à choisir les joueurs de son équipe. J’ai eu le sentiment de grimper dans l’échelle sociale, après n’avoir d’abord essuyé que des refus : « Non, on ne veut pas de filles. »
Et un souvenir de sport scolaire ?
Je me souviens qu’au collège, je gagnais tous les cross. J’ai découvert que je prenais beaucoup de plaisir dans l’effort et que je possédais des capacités physiques et pulmonaires très supérieures à la normale. Cette prise de conscience de mes qualités athlétiques m’a donné confiance et a nourri mon estime de moi. Cela a déterminé la suite de ma vie, de ma carrière de footballeuse professionnelle à aujourd’hui.
Et un souvenir plus récent ?
Avec quatre copines, nous avons participé fin juin au Grand Relais de l’Ultramarin, 175 km en relais autour du golfe du Morbihan, avec un départ à 20 heures et une bonne partie à courir de nuit. J’ai pris mon relais à 2 heures du matin, pour 30 km, et dans l’obscurité tous mes sens étaient en éveil. Les bruits de la nuit, les odeurs et les chauves-souris que l’on devinait tourner autour de nous : c’était une expérience intense, avec aussi la dimension collective. Et puis nous finissons 3e, sur le podium ! À 37 ans, je suis heureuse de rester performante et de prendre autant de plaisir à pratiquer.
Et un souvenir de vos années de footballeuse professionnelle, puisque vous avez joué en première division, notamment à Montpellier puis à Lyon ?
Le très bon souvenir qui me reste – car mon expérience de footballeuse a laissé en moi des traces douloureuses et indélébiles – ce sont les Jeux olympiques universitaires remportés en juillet 2015 à Gwangju, en Corée du Sud, alors que nous étions loin d’être favorites et avions même perdu notre premier match contre le Canada, 3-0. Avec mes coéquipières, je me sentais sur le toit du monde alors que, longtemps blessée, je sortais d’une saison très difficile avec l’Olympique lyonnais. C’était une émotion incroyable.
Y a-t-il un moment vécu qui, plus qu’un autre, vous a fait vous tourner vers les études de psychologie, sachant que vous possédez aujourd’hui un doctorat ?
Pour moi, ces études de psychologie étaient étroitement liées au choix de mon sujet de thèse. Celui-ci portait sur les « stéréotypes sexués explicites et implicites en contexte sportif » et faisait directement écho à une expérience de vie qui a laissé des traces : celle d’avoir évolué dans un milieu du football très masculin et hostile aux femmes, et de n’avoir jamais pu y trouver ma place. J’avais besoin de comprendre d’un point de vue plus théorique et scientifique ce que j’avais ressenti de façon empirique sur le terrain.
Y compris dans le football féminin ?
Oui, parce que nous sommes toujours rattachées à une section hommes et qu’on nous fait comprendre que nous ne sommes que des invitées. On nous a conviées pour l’apéro, mais il ne faut pas compter l’être aussi pour le dîner… C’est le sentiment que ça m’a laissé.
Qu’est-ce qui vous a amenée ensuite au slam ?
C’est un grand hasard : j’en faisais sans le savoir. Un jour, en 2021, j’ai publié une vidéo sur Instagram. J’ai eu des retours très positifs et on m’a expliqué que c’était du slam, en m’invitant à poursuivre dans cette voie. J’ai découvert qu’il existait près de chez moi, à Rennes, une scène ouverte de slam. J’y suis allée et on m’a encouragé à revenir la semaine suivante pour des sélections. Trois mois plus tard, je me suis retrouvée en finale des championnats de France de slam, un univers entièrement nouveau pour moi. Aujourd’hui, cela m’anime à titre personnel, professionnel, et m’a amenée jusqu’au Off du Festival d’Avignon, en cet été 2025.
Justement, quelle est l’origine de votre « seule en scène », « 140 BPM » ?
C’est le prolongement de mes conférences scientifiques vulgarisées, qui étaient devenues mon activité principale, activité que j’ai mise en sommeil après ma découverte du slam. Le slam, c’est ce qui, en trouvant les mots, m’a permis d’exprimer des choses qui restaient coincées à l’intérieur, et ainsi d’avancer et de guérir. J’ai transformé l’essence de mon message en des textes poétiques. En quatre ans, j’ai dû écrire près de 60 textes. Parmi ceux-ci, certains auxquels j’étais particulièrement attachée étaient étroitement liés à mon histoire. D’où l’idée d’en faire une performance slamée. Le projet a mûri et est devenu un spectacle en huit chapitres, une déclamation façon spoken word, comme le fait Grand Corps Malade, mais sur une musique électro composée par Bleubec.
Et pourquoi ce titre, « 140 BPM » ?
Parce que c’est aussi celui du texte qui vient clore le spectacle. « 140 battements par minute », c’est la fréquence cardiaque que j’aime atteindre quand je cours. C’est l’allure à laquelle je me sens bien, un peu essoufflée mais pas trop : celle où je peux faire le vide et le plein. Je me débarrasse à la fois de tout un tas de choses et trouve aussi la rime qui me manque pour terminer un quatrain. Il suffit que je mette mes baskets, et elle viendra.
Jouer devant un public dans un stade et sur une scène de théâtre, cela a-t-il quelque chose à voir ensemble ?
Oui, en partie. Les sensations et la tension ressenties sur les scènes de slam en compétition ressemblent beaucoup à celles qui pouvaient être les miennes avant d’entrer sur le terrain. Le slam est quelque chose de très « performatif » puisque vous avez trois minutes et neuf secondes pour convaincre l’assemblée de voter pour vous. C’est du sport, c’est court et c’est long, car cela demande à la fois endurance et explosivité. Vous ne pouvez pas trébucher sur les mots et devez respecter les silences, les respirations, le débit… Et le festival d’Avignon, une vingtaine de dates en trois semaines, c’était aussi un défi sportif. En même temps, c’est différent car seule en scène, la performance repose uniquement sur mes épaules. C’est un trac supplémentaire par rapport au foot.
Propos recueillis par Philippe Amelot pour PANARD



Ex-footballeuse professionnelle à Montpellier, Lyon et Guingamp, deux fois internationale, Mélissa Plaza, 37 ans, est docteure en psychologie du sport et l’auteure d’une thèse sur les « stéréotypes sexués explicites et implicites en contexte sportif ». Après un récit autobiographique sur son expérience de joueuse (« Pas pour les filles », Robert Lafont, 2019) et une reconversion comme conférencière, elle s’est également lancée dans le slam.